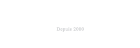|
Les métiers ont été tellement transformés par la mondialisation et
l’irruption de la nouvelle économie que l’image traditionnelle de l’Etat
pourvoyeur d’emplois est entrain de régresser au profit du concept
d’employabilité, c’est-à-dire de l’aptitude du diplômé à choisir son propre
métier, à s’adapter à un marché de l’emploi de plus en plus précaire en
raison de la désuétude de certaines professions et de l’émergence de
nouveaux besoins, de nouvelles technologies, générant, inéluctablement, une
approche originale en matière de débouchés, de longueur des études et de
contenu réel des formations universitaires.
Des filières ou des impasses ?
Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de
la technologie se doit de révolutionner les filières actuelles conformément
aux besoins de la société tunisienne et des mutations du tissu industriel,
appelé, plus que jamais, à remplir un rôle avant-gardiste dans l’intégration
des jeunes diplômés dans le marché du travail. Cela dit, d’après un document
conjoint du ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle des
jeunes et de la Banque mondiale, le chômage demeure un problème important
parmi les nouveaux diplômés universitaires, notamment chez ceux appartenant
aux filières du secteur tertiaire et affecte d’une manière plus particulière
les techniciens supérieurs dont le groupe de spécialités liées à
l’agriculture et à l’agroalimentaire se distingue avec des taux de chômage
nettement plus élevés (plus de 70% pour les techniciens supérieurs et plus
de 31% pour les ingénieurs).
Si les sortants des Instituts supérieurs d’études technologiques (ISET) se
trouvent légèrement avantagés sur le marché du travail, les diplômés issus
des cursus de gestion, finances ou droit connaissent un taux de chômage
élevé atteignant 68% pour les spécialités juridiques. D’après un expert de
la dite commission, à leur sortie du système universitaire, la majorité des
jeunes diplômés demeurent inactifs pendant plus de 15 mois, ce qui va, sans
doute, pousser le ministère de tutelle à revoir la lisibilité des filières.
L’urgence de l’adéquation :
« Il faut que les étudiants soient acheminés vers des filières qui
déboucheront sur des avenues, non vers des filières qui déboucheront sur des
impasses », insiste l’un des auteurs de l’enquête sur le suivi des diplômés
de l’enseignement supérieur. En effet, rien n’oblige à allonger inutilement
les études. Ou à faire obligatoirement une grande école. Il n’y a pas que
polytechnique dans la vie. Il faut favoriser, plus que jamais, les
passerelles entre cursus tout en encourageant les programmes de partenariat
entre écoles spécialisées et facultés à vocation généraliste. S’il importe
d’entamer ses études avec un objectif en tête, les meilleurs parcours sont
aussi les plus souples, ce qui doit pousser les décideurs universitaires à
promouvoir, dans les plus brefs délais, le jeu des admissions parallèles,
l’ancrage des filières innovantes en adéquation avec l’irrésistible
déploiement de l’économie immatérielle. Car les résultats de l’enquête
montrent l’existence de déséquilibres importants entre l’offre et la demande
d’un marché d’emploi, avide de cadres intermédiaires, formés dans des
secteurs à valeur ajoutée, vouées principalement à l’exportation. Il est
impératif de voir les responsables de l’enseignement supérieur coller aux
mutations économiques mondiales en adaptant des programmes
universitaires aux besoins des nouvelles données régionales et
internationales puisque le diplôme, la spécialité, la mobilité estudiantine
demeurent, d’après les conclusions de l’enquête, les principaux facteurs qui
expliquent les perspectives d’insertion professionnelle.
|