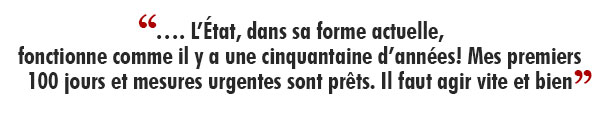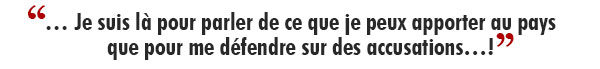Quand je le sollicite pour une interview, il hésite longuement. Son nom commençait à circuler à peine parmi les possibles chefs de gouvernement. Il m’accorde l’entretien à condition de ne le publier qu’après l’annonce du quartet et indépendamment du résultat. Adjugé! Le rendez-vous est pris. Je rencontre l’ancien ministre des Finances dans une ambiance qui lui ressemble, chic et élégante. Ponctuel, il sirote déjà un thé à la menthe à 16 heures piles et m’annonce qu’il répondra à ses appels durant l’interview. Il attend un coup de fil de Carthage, particulièrement important.
Boutons manchettes, chemise parfaitement repassée, blazer bleu nuit, l’homme aime les belles choses. Son goût du raffinement est flagrant. Il avoue faire de l’excellence, et dans tous les domaines, son mode de vie. «Je suis horripilé par l’à-peu-près, l’approximatif, le presque…».
Vous l’avez compris, Jalloul Ayed (JA) ne fait pas les choses à moitié. Les études quand il les finit, c’est avec brio. Son parcours professionnel est frappant, sa passion de musicien le mène à la composition d’une symphonie. Il s’en faudra de peu pour qu’il soit aussi champion de golf, puisque c’est un de ses hobbies!

Il se souvient du 27 janvier 2011, quand Mohamed Ghannouchi l’a appelé alors qu’il travaillait à Londres. “Il ne m’avait pas proposé le poste mais il m’a fait savoir que j’ai été désigné ministre des Finances”. 48 heures plus tard, il était à Tunis: “J’étais fier que mon pays fasse appel à mes compétences acquises au cours d’une longue carrière; j’étais fier de pouvoir rendre à mon pays tout ce qu’il m’avait apporté. Mais cette fierté ne dissipait pas l’anxiété que je ressentais».
Partage-t-il toujours cette même anxiété aujourd’hui? Il répond: «Mon pays a de nouveau besoin de moi. J’ai un devoir envers lui et me dois de répondre, sachant que la tâche ne sera pas facile. J’ai quelques solutions et une vision que j’ai présentée dans un livre “La route des jasmins“. Le contrat du moment est on ne peut plus clair: rétablir la confiance, redorer l’image de la Tunisie à l’international et porter la Tunisie vers de nouvelles élections. Le tout porté par un consensus inconditionnel pour une trêve dont le pays a urgemment besoin».
La bonhomie et le sourire généreux de JA ne cachent pas tout à fait son côté rigide et limite intraitable. Il paraît évident que s’il accepte le poste, c’est à ses conditions! Négocier, ça il le connaît! Homme d’affaires avisé, il travaille, entre autres, sur la production de produits technologiques entièrement tunisiens d’ici à la fin de l’année, semble ne jamais être pressé même s’il sait d’avance qu’un éventuel succès à la tête du prochain gouvernement qui mènera le pays vers de futurs élections risque d’être périlleux.
Un risque qu’il court? Une dose d’audace ou une expérience inestimable à rajouter à son Curriculum Vitae? (Des bruits circulent que c’est la BAD qu’il a dans le viseur). A 62 ans, JA est l’un des rares ministres du gouvernement Béji Caïd Essebsi à ne pas avoir pris de positions politiques ni à adhérer à un parti comme l’ont fait les anciens ministres, Saïd Aidi ou Yassine Brahim.
JA se définit comme un technocrate. Il estime que si la transition démocratique patauge autant, c’est qu’il aurait été plus adroit de permettre aux technocrates de dresser et parer aux urgences et d’amorcer les réformes qui auraient été assurées indépendamment des gagnants aux élections. Les partis politiques auraient alors eu le temps de se réorganiser et la population de se forger une maturité politique pour éviter les choix émotionnels. Il estime qu’en pareille période, un parti peut avoir des urgences différentes de celles d’un pays. Entre temps, ce dernier s’enfonce dans des difficultés monstrueuses qui coûteront de plus en plus cher à résorber et qui prendront de plus en plus de temps.
Pour Ayed, il est primordial de travailler sur une question fondamentale: refaçonner l’Etat. «Passer d’un État-providence à un Etat-partenaire, dont la vocation est de contribuer à tirer le citoyen vers le haut» est son crédo. Bien que pondéré, JA ne cherche pas à cacher son inquiétude. Economiquement, la Tunisie va de mal en pis. Le déficit budgétaire a augmenté pour atteindre plus de 8%, le pouvoir d’achat des Tunisiens baisse, les réserves de change diminuent et n’ont été sauvées que par les nouveaux emprunts du gouvernement, l’inflation augmente et a atteint plus de 7% au cours de l’année 2013, et le taux de croissance en 2013 qui ne dépassera pas les 2,7% est nourri presque entièrement par la consommation.
Toutes les lignes de l’économie tunisienne sont dans le rouge et sans vraiment l’avouer, JA pense que c’est dramatique de ne pas se concentrer sur ce qui nourrit les populations.

«Sans gouvernement fort, rien ne réussira!», dit-il. Il faut foncer et oser. Et cela passe par le retour de l’investissement. Quasiment à l’arrêt depuis le premier assassinat politique dans le pays, celui-ci est «l’épine dorsale du développement économique», assure-t-il.
En Tunisie, malgré les encouragements», il n’y a toujours pas de structure forte d’investissement… L’État est le plus grand employeur et le plus grand investisseur et cela n’est plus viable». JA plaide donc pour un détachement de l’Etat de son rôle de «centralisateur». Il résume sa vision comme suit: «Un État intelligent transpose les pouvoirs d’un État qui croit tout savoir à une société qui sait». Autrement dit, une économie de connaissances. Son modèle est Singapour, un pays un peu plus grand que Djerba dont le PIB est de 350 milliards de dollars (le PNB de la Tunisie ne dépasse pas les 48 milliards de dollars. Tout le Maghreb sans hydrocarbures réalise à peu près le même PIB que Singapour).
Dès qu’il se met à décortiquer la situation économique du pays, JA devient intarissable. «Nous avions un système bancaire qui marchait au début des années 80 mais il n’a pas su s’adapter», déplore-t-il, et a mis hors jeu le pays malgré des possibilités de développement énormes, notamment en Afrique. Reconnu comme étant l’un des instigateurs du renouveau de la BMCE (Banque marocaine du commerce extérieur), JA estime que «c’est l’investissement marchand qui fait la différence, et qui est le réel créateur de valeur».

Un de ses plus gros chantiers est bien entendu la création de fonds d’investissement qui sont destinés à financer les jeunes entrepreneurs. JA estime qu’en Tunisie, l’investissement souffre du manque d’opportunités de financements pour les nouveaux entrepreneurs, mais aussi par l’archaïsme des anciens entrepreneurs qui refusent d’ouvrir le capital de leurs entreprises aux détenteurs de fonds. Il argumente: «Le plus important c’est d’inculquer la culture de marché aux entrepreneurs, et la meilleure solution, c’est la solution de démonstration… Lorsque l’entrepreneur voit son concurrent ouvrir son capital et réussir, il fera de même». Un exercice qu’il maîtrise. Lui-même a créé la plus grande plateforme de «Private equity» au Maghreb et en Afrique alors qu’il était au Maroc.
Jalloul Ayed n’a pas vécu directement les années Ben Ali, il quitte la Tunisie en 1987, et a encore moins eu à les subir. Durant le régime de l’ex-président, il a vécu à l’étranger entre les Etats-Unis d’Amérique, les Emirats Arabes Unis, Londres et le Maroc: «Je suivais tristement ce qui se passait dans le pays. Je souhaitais lancer une fondation pour aider les élèves brillants de Khniss (gouvernorat de Monastir), la région où je suis né, mais je n’ai pas obtenu d’autorisation. Je pensais souvent à mon père qui était chef de gare et vouait un profond respect à mon oncle qui travaillait dans l’armée. Ils m’ont appris le sens de la rigueur et du respect».
Fidèle à ses origines, il avoue aussi être fidèle à ses amis qu’il garde depuis longtemps, à la femme qu’il a épousée il y a plus de 33 ans et à ses copains. On le dit aussi fidèle à son «clan», il répond que son clan est son pays, composé de sahéliens et fortement soutenu par certains de l’ancien régime dont la famille parente à Ben Ali, les Mabrouk. Dans les milieux initiés, on l’accuse d’avoir taillé un décret sur mesure pour leur permettre de passer entre les mailles du filet de la Commission de confiscation des biens mal acquis du clan Ben Ali au lendemain du 14 janvier 2011.
Si on dit souvent que la réussite ne fait pas que des amis, il va sans dire que le pouvoir, s’il lui revient, n’arrangera certainement pas les choses!

Imperturbable, JA poursuit concernant la campagne de dénigrement dont il fait l’objet: «Des bobards auxquels vous devez rajouter que je suis un vendu, un franc-maçon, un sioniste, que j’ai une double nationalité… Les Mabrouk, parlons en! Je connais le cadet des trois frères qui m’a proposé un jour de gérer la BIAT. Je n’ai jamais eu de rapports professionnels avec eux….Kamel Ltaeif, je ne l’ai jamais rencontré! Et puis, vous savez, je suis là beaucoup plus pour parler de ce que je peux apporter au pays que pour me défendre sur des accusations dont je ne connais presque pas les fondements!».
Cependant, JA sort de sa réserve et livre, via le journal «Echourrouk», un entretien où il dément tout ce dont il est accusé. Il se réserve le droit de poursuivre en justice ceux qui salissent son honneur. Tant que les bobards qui circulaient sur les réseaux sociaux passaient encore, mais que des propos irrespectueux et diffamatoires soient exprimés par des représentants de partis politiques et des personnalités publiques, c’est inadmissible.
Dans les cercles politiques et à quelques journées de la encore (possible) désignation du futur chef du gouvernement de Tunisie, JA reste discret. Homme de communication, il disparaît complètement des médias, estimant ne pas être en campagne. Son nom est désormais associé soit à une menace qui risque de s’abattre sur le pays avec une privatisation outrancière, soit à une opportunité car il est un des rares candidats à avoir suffisamment de dimension pour pouvoir rassurer à l’international.
Son nom s’est aussi lié à la Caisse des dépôts et consignations, un projet qui dispose d’un pactole d’un peu plus de 4 milliards de dinars qui est considéré comme le bras financier de l’Etat et un pivot central dans la stratégie de relance économique. Or, une grande opacité entoure le dossier qu’il n’a plus géré. Dans les milieux initiés, on s’alarme et certaines sources dévoilent que la Caisse serait détournée de ses objectifs.
A quelques jours de la réussite ou de l’échec de l’initiative du quartet pour extraire la Tunisie de la fortement délicate situation dans laquelle elle se trouve, Jalloul Ayed est de toute façon hissé au premier plan des personnalités tunisiennes.
S’il n’est retenu pour la mission d’un futur chef de gouvernement dont les principales qualités est d’avoir une parfaite connaissance des problématiques et limites du pays, d’avoir une riche expérience dans les rouages de l’administration tunisienne, et de présenter une compétence dans la synthèse des priorités et la conduite des hommes, Ayed a bel et bien le pied dans l’étrier politique.
Transformera-t-il l’essai? Seuls les premiers cent jours de sa gouvernance, s’il venait à être chef du gouvernement, sauraient répondre à la question. D’homme d’influence il aura à passer un Homme de pouvoir. Faute de quoi de banquier, il aura aussi à passer à homme politique.