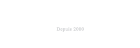Un colloque scientifique sur les climats de tension et leur impact sur la coexistence démocratique a eu lieu, samedi à Tunis, à l’initiative de la “Coalition Awfia pour la démocratie et la transparence des élections”.
Les participants à ce colloque ont été unanimes à souligner l’existence d’une “crise générale” qui touche notamment les médias, les réseaux sociaux et la sphère politique sur internet. Cette crise a eu un impact sur la coexistence démocratique, ont-il affirmé.
Brahim Zoghlami, directeur de programme au sein de la coalition, a affirmé qu’un monitoring du discours de haine sur les réseaux sociaux au cours des élections locales a dévoilé l’existence d’une crise multidimensionnelle. Cette crise s’est explicitement manifestée dans la couverture effectuée par les médias qui, a-t-il dit, n’était “pas du tout professionnelle”.
Selon lui, cela s’explique notamment par “le manque de professionnalisme” et une volonté d’instrumentaliser les médias.
Zoghlami a estimé que le décret-loi n°54 qu’il a qualifié de “catastrophique” pour les médias et pour la liberté d’expression, pourrait être aussi une des raisons. Selon lui, ce décret-loi a poussé les journalistes et les citoyens en général à s’autocensurer notamment sur les réseaux sociaux.
De son côté, le professeur en sociologie, Adel Ayari, a déclaré qu’un langage violent, est apparu ces dernières années, chez tous les acteurs politiques.
Et d’ajouter “l’utilisation intensive de ces termes haineux est devenue un outil d’analyse politique et d’interaction chez toutes les parties”. Selon lui, “l’exercice de la violence verbale est devenu un contexte dans lequel nous vivons et par lequel nous sommes influencés”.
Pour l’universitaire, “les risques de cette violence ne se limitent plus aux médias mais englobent aussi tous les supports et plateformes.”
Il a ajouté qu’une étude menée par la “Coalition Awfia pour la démocratie et la transparence des élections”, du 2 au 5 février 2024, a révélé que “les termes violents sur Internet sont utilisés par une génération entière (âgée de 20 à 45 ans), ce qui montre que ce phénomène n’est pas spontané mais est le résultat d’une politique systématique qui a duré des décennies, réprimant la communication et la sensibilisation dès l’école et limitant les discussions à des sujets marginaux qui ne peuvent pas contribuer à créer une génération qui respecte les différences et est capable d’utiliser des outils de débat pacifique”.