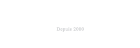L’antique Aradi, l’actuel Sidi Jdidi à une quinzaine de kilomètres de Hammamet, le village berbère Douar Laaroussi, les collines d’El Monchar, le site archéologique Aradi et les grottes préhistoriques de Sidi Latrach, sont autant de sites révélés pour être une composante importante du nouveau et premier parcours de la Route des Randonnées de Tunisie crée à Sidi Jdidi-Nabeul, dans le cadre du projet « Trans-Tunisia Trekking Trail » (La Route des Randonnées en Tunisie).
Réalisé en partenariat avec Leaders International et soutenu par le projet « Promotion du Tourisme durable en Tunisie » – une action conjointe de l’Union européenne en Tunisie dans le cadre de son programme Tounes Wijhetouna et du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat étroit avec le ministère du tourisme tunisien.
Ce nouveau circuit pédestre offre à voir une riche destination de montagne, d’aventure mais aussi de culture et d’histoire pour découvrir des richesses peu ou mal connues telles que les grottes préhistoriques de Sidi Latrech que l’on peut voir dans la vidéo promotionnelle de ce nouveau circuit.
“Un nouveau circuit de randonnée unique pour explorer les richesses naturelles et historiques de la région de Sidi Jdidi et Nabeul en Tunisie.”
Ces grottes, selon quelques données historiques, étaient des chambres funéraires groupées, étagées et creusées dans la masse rocheuse Djebel Sidi Latrach. Elle sont connues aussi par Houanet (pluriel hanout, pour désigner une chambre sépulcrale creusée dans le roc) et attestent d’une présence humaine très ancienne aux environs de Hammamet. Ces chambres creusées et taillées par l’homme préhistorique pour éterniser ses morts remonteraient selon des données historiques, à la protohistoire, période comprise entre la fin du néolithique et le début de l’histoire ce qui équivaut à l’âge des métaux en Europe.
En arrière de la zone côtière d’Hammamet, à une dizaine de kilomètres de la mer, le site Sidi Jdidi, identifié par une inscription avec l’antique Aradi, s’étendant sur une dizaine d’hectares a fait l’objet de nombreuses études, recherches, d’ouvrages et d’articles clés pour étudier les monuments révélés dont deux basiliques chrétiennes composant la cathédrale double qui eut une fonction funéraire illustrée par les nombreuses mosaïques signalant les tombes, lit-t-on-on dans la collection “Les Nouvelles de l’archéologie”, (sur le portail de livres et de revues scientifiques OpenEdition Journals). Intitulé “Les églises de l’ancienne Aradi” .
Un texte scientifique datant de 2011 est rédigé par l’archéologue et historienne tunisienne Aïcha Ben Abed Ben Kheder et l’archéologue médiéviste Michel Fixot, membres de toute une équipe de fouilles de la campagne de l’été 2006. L’idée de fouille était de l’archéologue Paul-Albert Février, (1931-1991) un historien, archéologue et épigraphiste français spécialiste de l’Antiquité tardive.
“Un voyage dans le temps vous attend sur la Route des Randonnées de Tunisie, à la découverte des vestiges de l’antique Aradi et des grottes préhistoriques de Sidi Latrach.”
“Le désir de P.-A. Février d’établir des relations plus étroites avec le « Maghreb romain », fondées sur un travail de terrain, est à l’origine de l’étude du site de Sidi Jdidi.
La perspective était d’abord d’exploiter les sondages qui avaient été conduits une vingtaine d’années plus tôt par les services de l’Institut national d’art et d’archéologie tunisien, devenu depuis l’Institut national du patrimoine (INP). Ces interventions avaient eu comme but de montrer l’importance potentielle du gisement archéologique alors menacé par des projets d’équipement – la construction d’un barrage, qui fut effective – et d’installation d’un habitat villageois.
Parmi les monuments révélés partiellement à cette époque se trouvaient deux basiliques chrétiennes, dont une complétée par un baptistère de plan « en rosace » attribuable par sa forme à l’époque byzantine. Le relevé des vestiges était donc devenu une urgence, d’autant que des sols mosaïqués avaient été mis au jour, avant de prévoir d’étendre les surfaces soumises à la fouille afin d’obtenir une compréhension plus globale.